« Le féminicide c’est ça : marquer violemment le corps des femmes et en faire une menace pour les autres : afin que les femmes ne puissent pas dire non, afin qu’elles renoncent à leur indépendance. »i
La capacité des Argentins à descendre dans la rue pour protester est surprenante et efficace : le 3 juin 2015 ce sont ainsi plus de 250’000 personnes qui défilent dans les rues de Buenos Aires et la mobilisation n’est pas limitée à la capitale (plus de 120 manifestations ont lieu à l’intérieur du pays) ii. En ce 3 juin 2015, le mouvement « Ni una menos » est officiellement né. C’est sous l’impulsion d’un groupe de journalistes que tout a commencé ; un Tweet qui réclame l’arrêt des féminicides et l’appel est lancé. La raison de leur colère réside dans le nom du mouvement « Ni una menos », qui signifie « pas une de moins » et fait référence directe aux nombreux féminicides commis en Amérique latine.
Pourquoi pas « ni une de plus » ? On peut suggérer que cette variante mettrait en avant le crime (par une de plus tuée). Alors que dans la version « pas une de moins » on parle plutôt de la perte de l’être cher et du manque qu’elle laisse à l’entourage (pas une vivante de moins). De ces cas précis de féminicides, le mouvement lutte contre la violence de genre de manière élargie et n’a eu aucun mal à rassembler autour de cette thématique.
Le rôle des réseaux sociaux a été primordial dans l’élaboration du premier rassemblement du mouvement. En trois semaines, le hashtag #Niunamenos fait le tour du pays et exerce rapidement une pression sur les politiciens, appelés à mettre en œuvre une politique publique pour en finir avec les féminicides. Ce mouvement a donné une voix aux femmes qui subissent des violences et aux proches de celles tuées par la haine.
L’organisation n’a cessé de prendre de l’ampleur et a encore récemment déploré le meurtre d’une jeune Argentine dont même les médias européens se sont éprisiii. Si le mouvement de Ni una menos semble ainsi être limité géographiquement à l’Amérique latine, la vigueur avec laquelle il dénonce les atrocités commises en raison du sexe de l’individue pourrait cependant en inspirer d’autres.
Fémicide ou féminicide ?
Le mot de « féminicide » peut paraître fort, mais il est pourtant adapté : le féminicide est le meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme. C’est un triste fait qui s’ajoute aux violences de genre comme la violence conjugale, le viol, le harcèlement sexiste et autres violences verbales.
Avant de vouloir faire reconnaître un crime, il faut pouvoir le nommer et en définir les contours. C’est par miroir à « homicide » qu’apparaît pour la première fois le mot femicide en anglaisiv sous la plume de Jill Radford et Diana Russel. Selon Radford, le fémicide est tardivement reconnu et défini pour deux principales raisons.
D’une part, comparé à d’autres types de violence, les femmes victimes ne peuvent pas partager leur expérience et la dénoncer, la finalité du crime étant la mort. Deuxièmement, le décès relève souvent de la sphère privée et rendre politique une mort violente n’est pas chose aisée. En ce sens, le fémicide constitue un thème délicatv.
Quand diverses féministes mexicaines s’emparent de la méthodologie utilisée par Radfort et Russel, elles font face à un dilemme de traduction de l’anglais femicide. Selon Marcela Lagarde, la traduction directe de femicide (femicidio en espagnol, fémicide en français), ne ferait que simplement préciser que le crime a été commis sur une femme. Elle lui préfère alors le mot « féminicide » (feminicidio) qui souligne le caractère genré de la violence perpétréevi. Les recherches à ce sujet sont nombreuses en Amérique latine (notamment sur le cas de Ciudad Juárez, au Mexique) et soulignent l’idée de « sacrifice » ou de violence symbolique de ce crimevii.
Le discours tenu par Ni una menos explique que le féminicide est une violence de genre intégrée à une violence structurelle.
Le féminicide souffre des mêmes maux que le viol : une définition trop floue, une non-reconnaissance et une pénalisation insatisfaisante. Ces deux crimes sont soumis à la « victimology », c’est-à-dire le fait de rendre la victime responsable de ce crimeviii. Ce mode d’explication raisonne dans les discours qui mettent en cause le comportement de la femme, sa manière de se vêtir ainsi que ses actes dans le déroulé du crime, faisant de celui-ci la simple conséquence du comportement féminin. La notion de genre est ici fondamentale car la violence envers les femmes est perçue comme une manifestation de plus de la « domination masculine » et du système patriarcal en général.
La vision binaire et différentielle entre hommes et femmes intervient dans l’exercice de la violence car les catégories de genre impliquent des normes et des pratiques (sociales) au quotidienix. C’est ensuite l’institutionnalisation du social (dans la pratique du pouvoir, dans les lois) qui cristallise des rapports inégaux et violents : agir au niveau légal pourrait ainsi permettre de modifier le social.
Violence institutionnelle
Ce que dénonce aussi Ni una menos est l’invisibilité administrative dont jouit ce type de violence : il n’existe pas de registre officiel des féminicides commis en Argentine. Ceux-ci sont rapportés par une ONGx. Certains pays d’Amérique latine (Mexique, Costa Rica, Colombie et d’autresxi) reconnaissent le féminicide et le pénalisent, mais d’autres non. Au sein de ces pays, ce crime revêt donc deux aspects : à la violence de genre, misogyne, s’ajoute le sentiment d’impunité face à l’Étatxii. La violence à l’encontre des femmes est parfois désignée comme étant liée au trafic de drogues et autres activités criminelles ; en réalité, cela permet simplement aux institutions étatiques de se retirer d’un débat plus profond sur la misogyniexiii.
Lorsque l’État ne reconnaît pas une violation, il légitime donc à la fois cette violence et peut potentiellement discréditer le discours des activistes. Ni una menos demande ainsi que soient publiées des statistiques officielles sur la violence contre les femmes et notamment le nombre de féminicides. Cette démarche vise peut-être une prise de conscience de la part de la société civile mais surtout la reconnaissance de cette violence précise de la part des institutions. Si les premières manifestations ont permis de placer le féminicide dans l’espace public, il doit désormais intégrer la sphère politique et juridique.
En effet, d’une manière légale, une loi qui reconnaît précisément le féminicide permet la « reconnaissance sociale culturelle du fait que le fémicide est un crime différent des homicides en général »xiv. La définition que donne la loi a aussi un fort impact, par exemple si elle définit uniquement le féminicide dans le cadre du couple et non pas commis par un proche ou un inconnu, cela définit aussi ce que comptabilisent les statistiques nationales et peut alors tendre à donner une image différente de la réalitéxv.
La reconnaissance par l’État n’est qu’une étape mais la symbolique qui en découle est très forte. Elle permettrait ensuite, « par le haut », d’avoir un impact dans les mentalités.
 Ni una menos : vers un mouvement mondial ?
Ni una menos : vers un mouvement mondial ?
En Europe, on peut parler historiquement de féminicide lorsque l’on brûlait des prétendues sorcières sur la base d’accusations difficiles à réfuter. Bien que chaque époque connaisse ses mœurs et son contexte socio-culturel, le cadre analytique d’une telle violence reste inchangé : « Le maintien et la perpétuation du pouvoir sur la femme », notamment à travers la sexualité et la violence masculine à l’encontre des femmesxvi. Le cas des sorcières est particulier et mériterait un développement qui ne sera ici pas amorcé; il sert simplement à montrer de quelle manière la violence contre les femmes (dans la plupart des cas pour les sorcières il était bien question de femmes et non d’hommes) a été exercée lorsque celles-ci sortaient des cases auxquelles elles avaient été assignées. « Unlike crimes such as theft or robbery, witchcraft was not merely a crime against an individual person… it was a crime against God, and perhaps by inference, a crime against mankind. Furthermore, it was a crime almost impossible to deny once accused of it. »xvii
Il reste cependant aujourd’hui difficile de parler de féminicide en Europe, du moins en ces termes. Est-ce à dire qu’il est inexistant ? On peut tout d’abord imaginer le même problème de dénomination : comment différencier un meurtre conjugal d’un féminicide ? Une femme battue qui décède après plusieurs années sous les coups est-elle victime d’un féminicide ? Le féminicide est-il uniquement l’acte d’un meurtre violent ou peut-il aussi être un processus plus étendu dans le temps ? Ce type de question relève non seulement de la définition « sociétale » de ce crime mais d’autant plus de la législation nationale. Plusieurs auteurs signalent aussi le « continuum »xviii de violence subi par les femmes, à la fin duquel se trouve le féminicide. Les différentes violences sont interreliées et ce continuum dépeint cette violence comme « une forme de contrôle central au maintient du patriarcat »xix.
 Le premier pas à faire est certainement d’adopter la vision plus globale de la violence de genre. Le féminicide peut aussi représenter un « backlash against women who are empowered, for instance by wage employment, and have moved away from traditional female roles »xx, ce qui implique qu’il ne suffit pas de donner des opportunités mais qu’il est aussi essentiel de lancer un changement des mentalités sur le long terme.
Le premier pas à faire est certainement d’adopter la vision plus globale de la violence de genre. Le féminicide peut aussi représenter un « backlash against women who are empowered, for instance by wage employment, and have moved away from traditional female roles »xx, ce qui implique qu’il ne suffit pas de donner des opportunités mais qu’il est aussi essentiel de lancer un changement des mentalités sur le long terme.





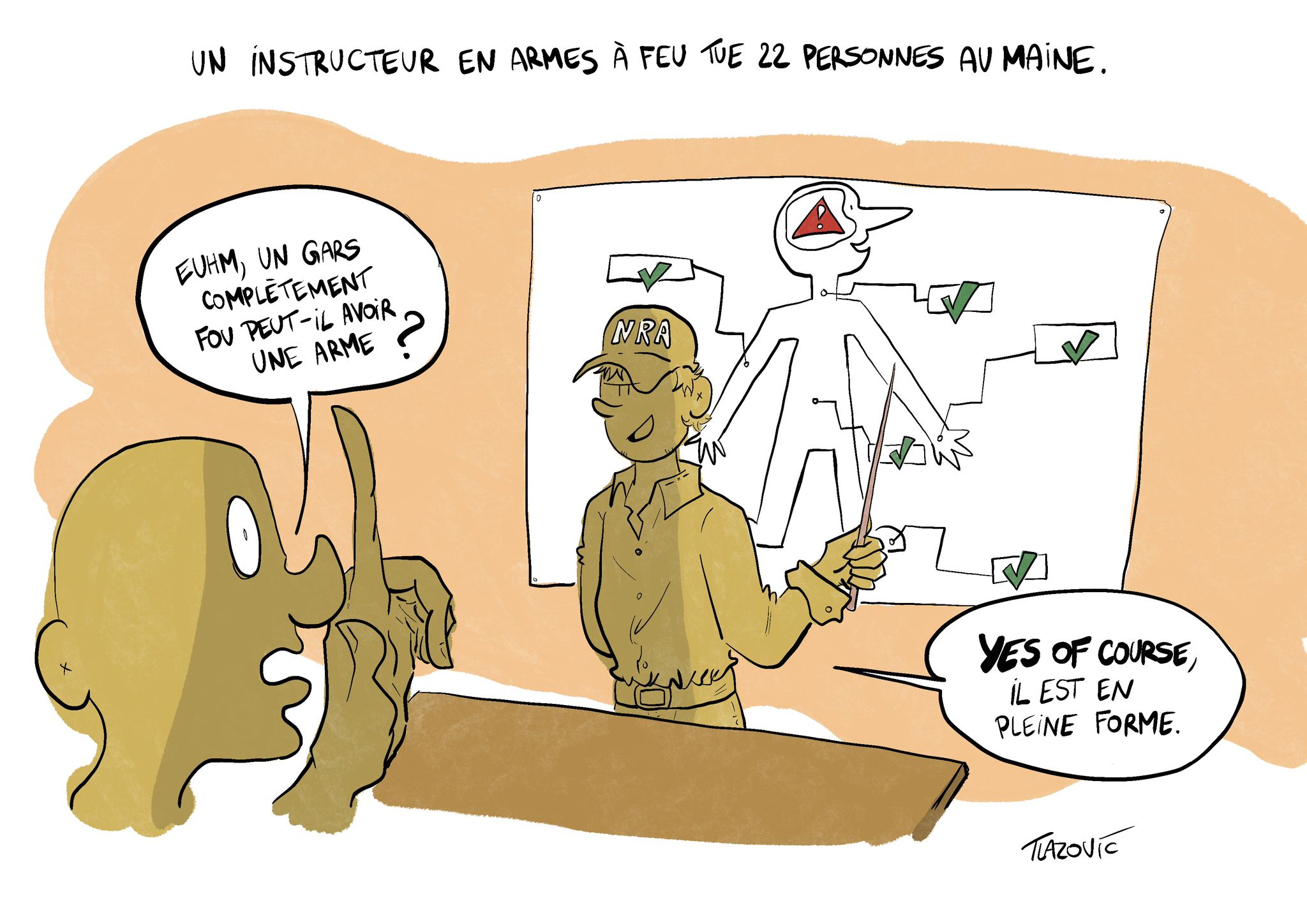
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.