Lorsqu’on traite de l’égalité homme-femme, on met souvent en avant les violences faites par les hommes sur les femmes. Cela n’a rien de surprenant puisque les femmes sont au premier rang lorsqu’il s’agit des inégalités entrainées par le système patriarcal (viols, agressions sexistes, inégalités salariales, plafond de verre, la « double journée » pour une femme qui a un travail rémunéré et doit en plus s’occuper des tâches ménagères non rémunérées et dévalorisées, langues française teintée de sexisme notamment dans l’utilisation d’insultes qui dévalorisent le genre féminin). Si les études féministes ont pendant longtemps mis en avant la violence des hommes sur les femmes, c’est probablement pour maximiser leur impact militant et politique, et ainsi ne pas saper leurs objectifs émancipateurs.
Pourtant, penser la violence des femmes n’est pas contradictoire avec une volonté égalitaire. Au contraire, montrer que certaines femmes sont violentes au même titre que le sont certains hommes permet de déconstruire l’attachement de la violence au sexe et au genre dit masculin. En somme, cela permet d’éviter le piège de l’essentialisation des hommes – habituellement rattachée à des caractéristiques dites masculines ou viriles telles que la force, la combativité et la rationalité – et l’essentialisation des femmes — habituellement rattachées à des caractéristiques dites féminines, telles que l’empathie, le pacifisme et le soin (le « care » en anglais).
« Les violences subies par les femmes expriment leur position de dominées. Ce qui n’exclut pas non plus que la violence masculine est inéluctable. Dans cette perspective, accepter que la violence masculine est le résultat d’une construction sociale, c’est du même coup refuser de considérer d’emblée les femmes comme des victimes, et accepter l’idée que les femmes aussi peuvent être acteurs de violence »
(Fougeyrollas-Schwebel, 2010, 38)
La différence entre sexe et genre
Avant d’aller plus loin, il est important de faire quelques précisions. D’abord, il est important de rappeler que ce qu’on appelle sexe est différent du genre.
Le sexe est souvent considéré comme l’interprétation biologique des organes génitaux en catégories – souvent binaires. Le genre, quant à lui, est une interprétation des rôles que la société attend d’un individu et qui est souvent rattaché à un sexe. Par exemple, quelqu’un avec un sexe d’homme sera socialement conditionné à avoir un comportement de genre masculin, mais il peut très bien être perçu ou se percevoir avec des caractéristiques de genre différentes tout en gardant une interprétation biologique masculine de son sexe : un individu peut se considérer comme « femme » tout en voyant son sexe comme « masculin ». L’expression « interprétation biologique » est à relever car il n’y dans ce texte aucune réalité biologique concernant le sexe, mais uniquement un choix politique d’interprétation et de différenciation de l’humain en catégories. Cela m’amène à mon deuxième point.
Dans cet article, les termes « sexe masculin » et « sexe féminin » renvoient à la binarité socialement perçue du sexe, et cela n’implique pas l’acceptation de cette binarité comme acquise et naturelle. En effet, même si couramment on distingue le genre du sexe en présentant le genre comme une interprétation sociale d’une réalité biologique (le sexe), il est difficile de parler de « réalité » pour désigner la classification binaire du sexe. L’existence de deux sexes biologiquement définis semble elle aussi issue d’une interprétation sociale (voire politique) : il existe deux sexes parce qu’on choisit de ne voir que deux sexes. Mais cette interprétation sociale laisse de côté tout un tas d’êtres humains nés avec parfois les deux sexes, parfois avec l’ensemble des caractéristiques d’un des deux sexes mais également avec un peu de ceux de l’autre, etc.
Ainsi, selon les critères utilisés et les choix d’interprétation, on peut tantôt compter cinq sexes (Fausto-Sterling, 2013), dix-neuf sexes (Valentine, 2007), voire même une multitude de sexes non nominaux positionnable sur des échelles progressives ayant à leurs extrémités une caractéristique biologique X ou Y qu’on aura choisi comme significative pour catégoriser les individus. Peu importe la classification retenue, l’important est d’avoir bien en tête qu’elle est issue d’un choix d’interprétation — soumise à des rapports de pouvoirs comme n’importe quelle décision collective — et non d’une réalité intangible et inaliénable.
De quelle violence parle-t-on ?
La manière de définir la violence rend le questionnement sur la violence des femmes difficile. De quelle violence parle-t-on ? La violence militaire ? Domestique ? Infantile ? Comment définit-on cette violence ? Comme une contrainte ou une domination comme le font Werber et Durkheim ? Comme quelque chose d’irrationnel (Jamin, 1984, 17), comme une « cruauté dépourvue de sens » (Balibar, 1996, 71) ou bien comme un « moyen qui échappe aux fins poursuivies par celles et ceux qui en font usage, et ne peut à ce titre fonder une légitimité politique » (Arendt, 1972, cité par Cardi et Pruvost, 2012, 14) ?
Certains auteurs mettent bien en avant la difficulté d’étudier la violence féminine en tombant dans l’écueil de l’excuse et de l’essentialisation : considérer que si une femme peut être violente, il s’agit d’une erreur, d’un acte excusable par le contexte et que dans une situation normale, cette femme n’aurait pas été violente (Cardi et Pruvost, 2012, 14). La maladie de l’hystérie féminine, considérée aujourd’hui comme une charlatanerie mais utilisée encore jusqu’au début du XXe siècle en Occident, était invoquée pour expliquer la violence de certaines femmes afin de ne pas briser le carcan normatif patriarcal dans lequel les femmes sont toutes pacifiques. Ainsi, certains psychanalystes tels que Wilhelm Fliess allaient jusqu’à expliquer qu’une femme, qui agissait alors en légitime défense par exemple, passait à l’acte sous l’impulsion d’un trouble lié à une bisexualité psychique. En somme, cette femme intervenait anormalement, c’est-à-dire comme un homme, car au fond d’elle, dans son inconscient, elle était un homme ou avait le désir refoulé d’en être un, comme l’explique Wilhelm Fliess.
Il faut donc choisir avec prudence la définition du concept de violence afin d’éviter de tomber dans de pareils écueils. Mardi et Pruvost présentent le choix judicieux d’une définition non discriminante et basée sur une approche interactionniste permettant de mettre en avant les mécanismes de genre au travers des relations sociales. Ainsi, on peut définir la violence comme quelque chose de performatif : est violent ce qui est perçu comme violent (Michaud, 2004 ; Jamin, 1984).
Comment est perçue la violence des femmes ?
Selon la littérature spécialisée, la perception sociale de la violence générée par les femmes semble pouvoir être classifiée d’au moins trois manières. Cette typologie exclut donc les catégorisations psychologiques et psychiatriques.
Premièrement, comme une violence « hors-cadre », c’est-à-dire que l’opinion ignore les violences commises par les femmes notamment en évitant de les nommer, afin de nier une réalité qui choque, car elle ne correspond pas à une perception genrée qui éloigne la femme de tout acte violent (Cardi, Pruvost, 2011). Par exemple, dans le domaine judiciaire, certains auteurs ont remarqué que les viols féminins sont renommés pour être qualifiés d’« attentats à la pudeur », car l’idée qu’une femme puisse violer n’est pas socialement acceptée (Giuliani, 2011).
Deuxièmement, la violence des femmes peut être interprétée comme étant une violence sous tutelle (Cardi, Pruvost, 2012, 28). Dans cette vision, « la femme violente n’apparait pas comme une figure trouble. Sa capacité d’agir est entamée et la dimension éventuellement subversive et politique de l’usage qu’elle fait de la violence est niée » (Cardi, Pruvost, 2012, 28). Autrement dit, la femme est perçue comme violente car elle est soumise à une domination externe, qui peut être interprétée sous les traits de « maladie mentale » (telle l’hystérie féminine au XIXe), mais également sous les traits de la soumission de classe (Perrot, 1979 ; Scott, 1990) ou de la domination masculine (Bugnon, 2012, 361-374 ; Kergoat, 2000).
Troisièmement, la violence féminine peut être présentée comme un acte d’émancipation qui peut conduire à deux formes différentes d’organisation sociale et politique : la domination matriarcale et l’indifférence égalitaire.
D’abord, la domination matriarcale peut prendre elle-même deux formes : politique ou micro-sociologique (Cardi, Pruvost, 2012, 38). La forme politique se rapporte aux différents mythes mettant en scène les femmes comme seules possesseurs du pouvoir politique (mythe des amazones). Peu de textes sérieux traitent de cette forme comme une réalité empirique existante ou n’ayant jamais existé. La forme micro-sociologique est plus réaliste (car elle ne fait pas référence à des mythes mais à une réalité) et porte sur la domination que certaines femmes peuvent exercer dans des contextes très précis, souvent à l’échelle micro ou meso (c’est-à-dire en dehors de toute structuration globale et politique). Par exemple, la domination en milieu domestique (Feldman, 2012), dans la sexualité (Poutrain, 2003), ou bien, de manière plus discutable, car elle s’exerce souvent sous la direction d’hommes, dans le milieu militaire avec la création de corps féminins de combat (Cardi et Pruvost, 2012, 43).
Ensuite, la violence féminine comme acte émancipateur peut aussi aboutir à une indifférenciation égalitaire (Cardi, Pruvost, 2012, 38). Dans cette catégorie peut être classé l’ensemble des formes de violence liées à l’obtention de droits politiques ou plus largement à une égalité hommes-femmes réelle.
Égaux dans la violence, mais soumis à des normes différentes
Étudier les différents types de violence causés par les femmes revient à explorer le monde des hommes car, comme le montre la typologie précédente, la violence des femmes est socialement construite et est souvent mise en miroir ou vue comme dépendante du monde des hommes (Scott, 1986; Kergoat, 1988).
Afin de déconstruire ces perceptions et de mieux les comprendre, au moins deux directions, complémentaires, peuvent être prises. D’abord montrer que la violence est exercée autant par les femmes que par les hommes, puis montrer comment les perceptions de genre peuvent influencer la manière dont la violence est exécutée. Par exemple, comprendre pourquoi de manière générale les violences subies par les hommes sont faites en grande partie par des hommes et non de manière égale par des hommes et des femmes. Autrement dit, il est bon de s’interroger sur comment les normes de genre créent de la différence autant dans l’exercice que dans l’interprétation et la réception de cet exercice de la violence (Cardi et Pruvost, 2012, 57).
Une autre interrogation soulevée par Eric Fassin mérite aussi une attention :
« Dans quelle mesure la violence des femmes mime-t-elle celle des hommes, au risque de la redoubler ? Et, à l’inverse jusqu’à quel point cette imitation, qui donne le sentiment de voir double, ne viendrait-elle pas aussi la troubler ? À l’instar de la violence des hommes, contribue-t-elle à faire l’ordre des sexes — ou a-t-elle au contraire l’effet paradoxal de le défaire ? »
(Fassin, 2012, 344).
Des pistes d’analyse
Le champ d’études reste encore peu exploré, et le travail à faire est encore important pour mieux comprendre les mécanismes de genre au travers de la violence des femmes. Les écueils sont nombreux et les explications psychologisantes ou naturalisantes ne seront que des obstacles parmi d’autres venant troubler une approche purement basée sur les apports des sciences sociales. L’étude de la violence chez les femmes révèle des comportements similaires chez certains groupes de femmes dans des conditions spécifiques. En effet, les normes de genre et les attentes sociales qui leurs sont liées, placent ces femmes dans des contextes qui favorisent certaines formes de violence par rapport à d’autres. Ainsi, les concepts socialement construits tels que la « race » ou bien les différences de classe agissent sur la manière dont les femmes vont exercer la violence : le genre doit être compris comme un outil intersectionnel, c’est-à-dire qu’il influence le comportement autant qu’il est co-construit par d’autres concepts. Par exemple, la violence infantile et l’inceste sont souvent davantage exercés par des femmes (voir par exemple Giulliani, 2011), alors que les violences sexuelles sur un-e conjoint-e sont davantage exercées par des hommes en France d’après l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
D’un point de vue militant ce travail est également important pour faire des humains égaux, égaux sur tous les aspects sociaux, y compris dans la manière dont nous percevons leur exercice de la violence.



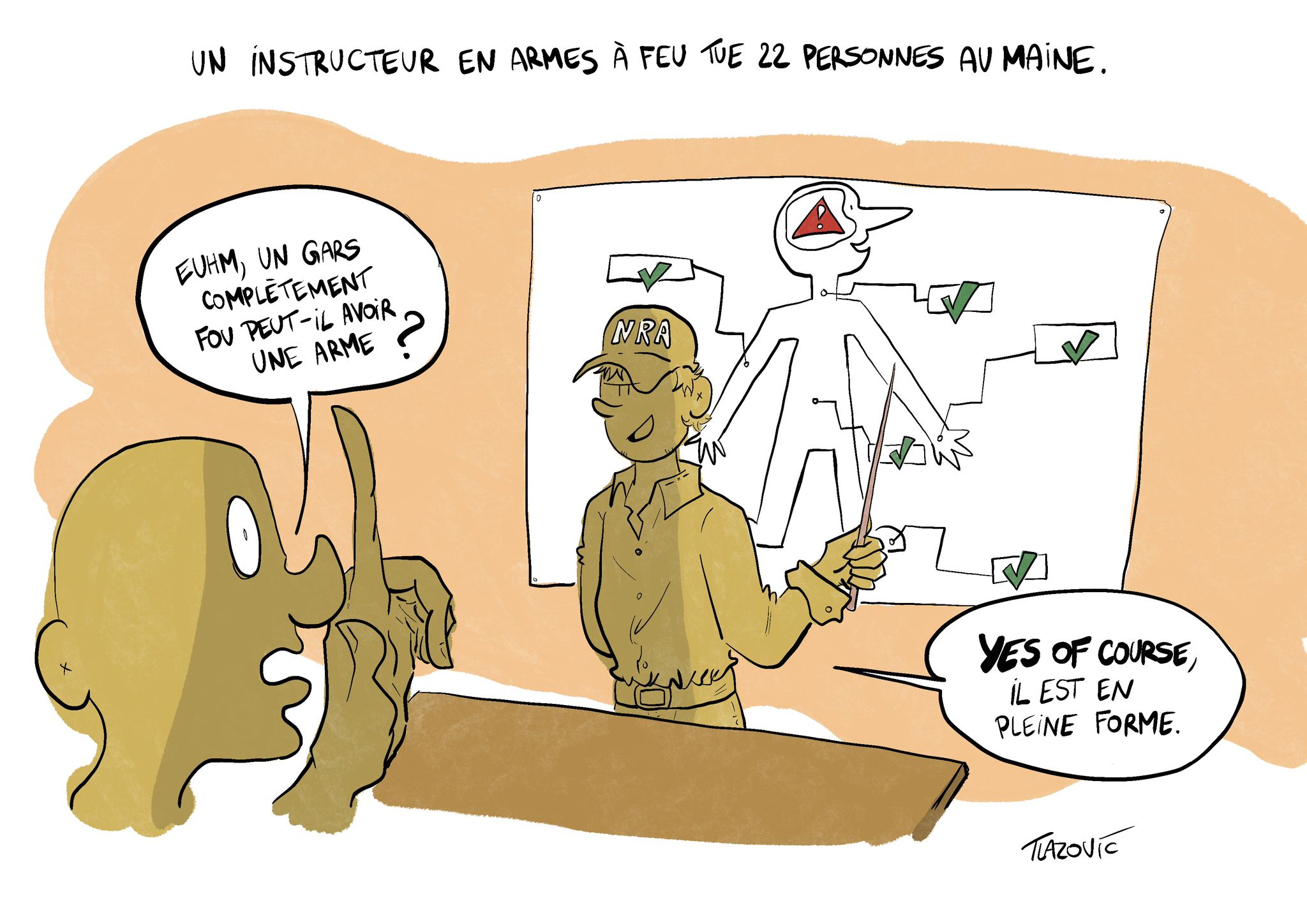
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.