En termes techniques, la police d’assurance désigne le contrat que l’on passe avec un assureur mais, dès le 25 novembre prochain, ce terme pourrait bien désigner un service administratif de la compagnie d’assurance, un groupe de détectives partant chasser le « fraudeur ».
Jusqu’en 2016, les assurances sociales ont surveillé leurs assurés qu’elles soupçonnaient de fraude, le tout sans base légale suffisante. Puis, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré qu’il fallait qu’une telle atteinte à la sphère privée soit prévue par une loi. Le lobby des assurances a alors fait jouer ses relais au Parlement fédéral pour, en moins d’un an et demi, mettre sous toit la si précieuse modification de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), par le biais d’une initiative parlementaire[1].
Pourquoi et pour qui ?
Un tel empressement de la part des assureurs laisserait supposer que la surveillance est essentielle au bon fonctionnement du système. Mais qu’en est-il des chiffres ? Entre 2012 et 2016, le nombre moyen de bénéficiaires d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) était de 227’000[2] (soit moins de 1%) et le nombre de cas suspects examinés se montait en moyenne à 2100 par an, selon le rapport[3] de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E), qui a rédigé la loi. Seuls 240 de ces cas ont fait l’objet d’une surveillance, qui n’a été fructueuse que pour 130 d’entre eux. Ainsi, en moyenne, seuls 11% des cas suspects requièrent une surveillance. On constate également que 45% des surveillances ne permettent pas de confirmer les soupçons pesant sur l’assuré. On peut en conclure que seuls environ 6% des cas suspects sont effectivement clarifiés grâce à une surveillance. En conclusion, seuls 0,06% des bénéficiaires d’une rente l’AI sont reconnus coupables au terme d’une surveillance.
L’exemple ci-dessus se concentre sur l’AI mais la nouvelle loi modifie la partie générale du droit des assurances sociales. Elle deviendrait donc applicable également à l’Assurance-accident (AA), à l’Assurance-chômage, aux Allocations pour perte de gain (APG), à l’Assurance-maladie de base, à l’Assurance-militaire (AM), aux Prestations complémentaires (PC) et au système de retraite (AVS). Le fait que cette loi ratisse aussi large explique également la forte mobilisation du lobby des assurances.
Comment ?
Mais pourquoi tant d’agitation et qu’apporte cette modification législative ? Le but est de permettre aux assurances d’effectuer des observations de leurs assurés soupçonnés d’abuser de leurs prestations. Concrètement cela signifie que l’assurance pourrait « observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser » (nouvel art. 43a al. 1 LPGA[4]) si elle « dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations » et que « sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles ». Selon l’Office fédéral des assurances sociales, une observation est l’ultime moyen de lutte contre les abus et « sert à constituer des preuves »[5]. On constate pourtant que 45% des surveillances ne donnent pas de résultat et ne remplissent donc pas ce but. On peut ainsi se demander si les indices sur lesquels se base la surveillance sont vraiment « concrets ».
Pour les partisans de la nouvelle loi, la lutte contre de tels abus de prestations est un intérêt public justifiant de porter atteinte à la sphère privée. Ils considèrent que les garde-fous sont suffisants car une surveillance ne serait ordonnée qu’en dernier recours. Les opposants considèrent pour leur part qu’il est problématique que ce soit un employé de l’assurance qui puisse décider de lancer la surveillance. En effet, l’autorisation d’un juge ne sera nécessaire que si le recours à des instruments de localisation (par exemple des balises GPS) est envisagé.
Combien de temps ?
La loi prévoit que l’assuré soupçonné pourra être surveillé 30 jours sur une période de 6 mois, prolongeable jusqu’à un an, quelle que soit la durée de surveillance sur la journée (art. 43a al. 5 LPGA). En clair, si un assuré est surveillé à une certaine date, cela compte pour un jour, que la surveillance journalière dure une ou 24 heures. Par ailleurs, l’assurance étant compétente pour ordonner la surveillance, elle le sera aussi pour prononcer la prolongation du délai.
Où ?
L’assuré pourra être observé s’il se trouve dans un lieu accessible au public (rue, magasin, restaurant, etc.) mais aussi dans un lieu « librement visible depuis un lieu accessible au public ». Il y a durant la campagne une importante controverse pour savoir ce que désigne cette dernière catégorie. Clairement, une personne se trouvant sur un balcon qui serait visible depuis la rue pourra être observée. La question devient cependant plus délicate – et donc d’autant plus importante – lorsqu’on envisage d’autres situations : une personne se trouvant dans une chambre ou un salon visible depuis la rue pourrait-elle être filmée dans son intimité, par exemple ?
Les partisans se basent sur un arrêt[6] du Tribunal fédéral (TF) qui a considéré en 2012 que des observations réalisées par exemple dans une cage d’escalier ou dans la buanderie d’un immeuble ne sont pas admissibles. On ne peut cependant pas exclure qu’un changement de la loi entraîne également un changement de jurisprudence, la question étant alors de savoir s’il revient au TF de décider de ce qui est admissible dans sa jurisprudence ou si cela est la responsabilité du Parlement qui aurait alors dû le régler dans la loi.
Par qui ?
Qui sont ces gens, ceux qui demain, pourraient suivre les assurés ? Ici aussi, il reviendra à l’assureur de décider à qui il entend confier les observations. Il pourra s’agir d’un service interne à l’assurance ou de « spécialistes externes » (art. 43a al. 6 LPGA), c’est-à-dire de détectives privés mandatés spécifiquement pour telle ou telle surveillance. Ces détectives externes seront soumis à l’obligation de garder le secret et auront l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les données recueillies dans le cadre de l’observation. Un assureur pourra également utiliser le matériel recueilli par une autre assurance dans le cadre d’une surveillance que cette dernière aurait menée précédemment, ce qui implique un échange de données entre ces entreprises.
Pour les opposants, il revient cependant à la police d’enquêter sur les abus. En effet, la fraude à l’assurance est réprimée par l’art. 148a du Code pénal. Dans le cadre d’une enquête pénale, la police pourrait donc utiliser des mesures d’observation selon l’art. 282 du Code de procédure pénale (CPP). Cependant, l’art. 282 CPP prévoit uniquement des observations dans des lieux librement accessibles et exclut donc les lieux visibles depuis un endroit librement accessible. Ainsi, la nouvelle loi donnerait aux assurances plus de possibilités de surveiller leurs assurés que la loi pénale n’en donne à la police.
Et ensuite ?
Finalement, que se passera-t-il après une surveillance ? Si la surveillance confirme les soupçons de l’assurance, cette dernière réévaluera les prestations auxquelles l’assuré a droit et le lui signifiera sous la forme d’une décision. Avant de rendre cette décision, elle devra informer la personne surveillée et lui donner la possibilité de consulter l’intégralité du dossier, cela pour garantir son droit d’être entendue. Par ailleurs, selon les abus constatés, l’assurance déposera une plainte pénale pour fraude, comme elle le fait déjà actuellement[7].
Si la surveillance a échoué et qu’elle ne permet donc pas de confirmer les soupçons, l’assureur devra rendre une décision relative à la nature, la durée et le motif de la surveillance. Cela permettra à l’assuré de faire recours devant un tribunal pour contester la validité de la surveillance. Ici aussi, l’assurance devra permettre à l’assuré d’obtenir une copie de son dossier. Dans un tel cas, se pose la question du délai, qui, pour faire recours contre une décision, est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Cependant, dans la mesure où le dossier n’est pas automatiquement transmis à l’assuré, celui-ci devra le demander, ce qui prendra du temps. Par ailleurs, analyser un dossier portant potentiellement sur 30 jours d’observation est un travail extrêmement long. On peut donc craindre que, pressé par le temps, l’assuré dépose son recours sans avoir pris connaissance de l’entièreté de son dossier, ce qui le désavantagerait face à l’assurance, voire qu’il renonce simplement à se battre.
Conclusion
Cette nouvelle loi offre certes quelques garanties de procédure mais laisse tout de même une large marge de manœuvre à l’assurance, dont on pourrait mettre en doute l’objectivité. En effet, si des prestations sont versées à tort, l’assurance est la victime. Mais c’est également elle qui enquêtera ou donnera mandat à un tiers d’enquêter. Enfin, si elle considère que des prestations ont effectivement été indûment touchées, c’est encore elle qui décidera des mesures à prendre.
Une question fondamentale se cache donc derrière la loi sur laquelle nous voterons le 25 novembre 2018 : dans un État de droit, une entreprise peut-elle être à la fois victime, enquêtrice et juge ?




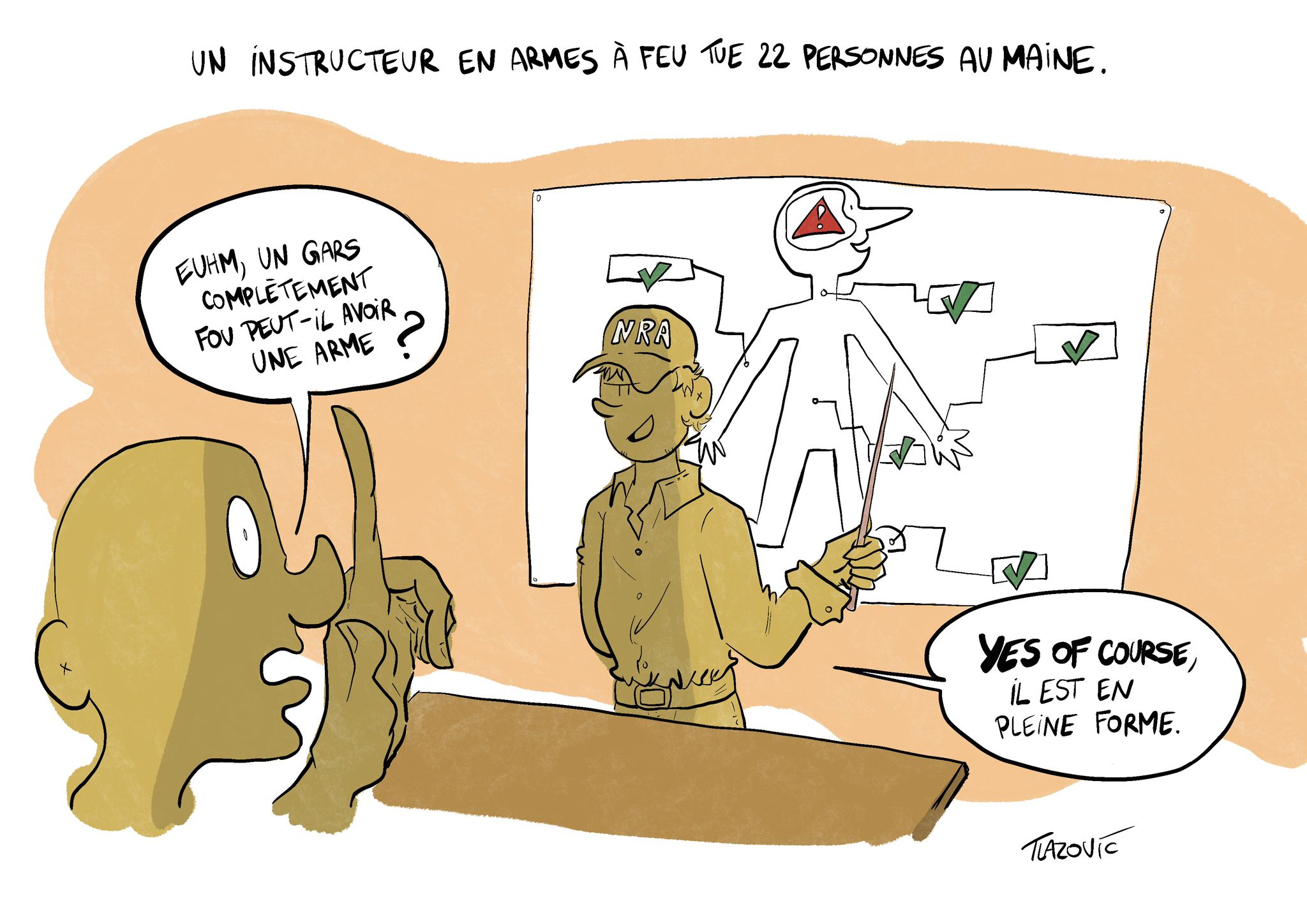
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.