Note TOPO : 5,9/6 Note artistique : 5,3/6
Le dernier épisode de Breaking Bad a laissé en vous un vide que toute la crystal meth du monde n’effacerait pas ? Vous ne vous êtes toujours pas remis du final des Sopranos et la mort de James Gandolfini n’a fait que rouvrir une blessure jamais vraiment cicatrisée ? Ou peut-être cherchez-vous simplement quelque chose de différent à vous mettre sous la dent ? Une solution existe pour vous, jeunes étudiants procrastineurs ! C’est sur The Wire (Sur écoute en français) que je souhaite attirer votre attention. Une certaine culpabilité vous ronge néanmoins à l’idée de vous plonger dans une nouvelle série à la place de réviser vos cours ? J’espère vous montrer qu’une œuvre de fiction déclinée sur ce format particulier peut allier rigueur intellectuelle et profondeurs thématiques, sans oublier un réel plaisir au visionnage. Signalons que The Wire est étudiée en milieu universitaire pour sa valeur sociologique et anthropologique notamment. L’université de Harvard l’a mise au centre d’un cours sur les inégalités sociales et l’université de Nanterre lui a consacré un séminaire intitulé « The Wire : a fiction in the ghetto. Race, classe et genre dans les séries télévisées »[1].
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Créée par David Simon, journaliste et ancien reporter au Baltimore Sun, et co-écrite avec Edward Burns, ex-policier qui fut également enseignant, The Wire est une série policière atypique. Diffusée sur HBO entre 2002 et 2008 et décrite par certains comme « la meilleure série de tous les temps », cette fiction nous plonge avec réalisme au cœur de la ville américaine de Baltimore (Maryland). Et c’est bien cette ville portuaire de la côte est des Etats-Unis, déshéritée et ravagée par la crise, qui sera le réel personnage principal tout au long des cinq saisons. Les enquêtes policières ne sont qu’un prétexte, un fil rouge qui nous guide durant cette radiographie des institutions américaines, sortes d’organismes broyant la volonté humaine ainsi que tout semblant d’american dream. Le résultat a la forme d’une photographie sans compromis de l’oncle Sam. Pas de photoshop ici, le maquillage se craquèle pour laisser apparaitre les cernes, les rides et les cicatrices d’un système malade.
Ne vous laissez pas déstabiliser par le rythme narratif qui peut sembler lent au premier abord. Cela peut déconcerter et rendre plusieurs épisodes nécessaires à une immersion totale dans le récit. Cependant l’effort initial sera largement récompensé par un voyage d’une pertinence et d’une intensité rarement offertes à la télévision. Cette lenteur nous permet de nous imprégner des ambiances et contribue à rendre l’expérience réelle. Une enquête ne prend pas un épisode, mais une ou plusieurs saisons. Les moyens à disposition sont nécessairement limités. Aucun Etat héroïque luttant contre le terrorisme ici, pas de supers experts entourés de technologies ou encore de grands méchants à terrasser. Trafiquants et policiers savent que leur existence et leur raison d’être sont intimement liées. De plus, la volonté des réalisateurs de ne pas prendre le spectateur par la main, de ne pas lui expliquer toutes les ficelles, donne une ambiance particulière au récit et renforce le plaisir réitéré à la découverte de chaque nouvel épisode.
/Culture/Entrees/2013/10/25_Way_down_in_the_hole_%28the_Wire%29_files/the_wire_wallpaper_2-normal.jpg)
Ce réalisme est également renforcé par l’utilisation particulière de la musique. Souvent présente, elle n’est jamais utilisée pour renforcer la dramaturgie. Nous entendons la musique par les mêmes sources que les personnages (autoradios, chaines stéréo, etc.). Cette manière de procéder ne met de loin pas la musique au second plan. Elle participe elle aussi à définir un milieu social particulier. De la musique irlandaise des Pogues au vieux rock crasseux très seventies aux forts relents d’alcool bon marché, sans oublier la scène hip-hop de Baltimore particulièrement mise à l’honneur, l’expérience The Wire est autant auditive que visuelle. Par ailleurs, le titre de cet article renvoie à la chanson qui a été choisie comme générique pour la série, « Way down in the hole », originairement composée par le génial Tom Waits et figurant sur l’album Franks Wild Years (1987). Élément intéressant, l’interprète de la chanson change pour chaque saison.
En multipliant les points de vue, la série refuse tout manichéisme. Du bon flic à l’incapable, du flic moyen au flic zélé, du toxico au dealer, du carriériste à l’idéaliste, des indics aux ripoux : constamment tiraillé entre sa morale, ses possibilités et ses projets, chaque personnage a une complexité et une profondeur qui le rend authentique. Ils ont tous des contraintes structurelles et un milieu qui les forge. Il y a un duel essentiel qui oppose l’individu aux institutions : certains s’en servent quand d’autres sont contraints d’y sacrifier leurs idéaux.
Le fait qu’il n’y ait pas un personnage principal à proprement parler n’empêche pas que la plupart des protagonistes nous accompagnent sur toute la durée de notre voyage à Baltimore. La majorité des personnages, comme dans la plupart des séries, sont récurrents. Cet élément nous permet de développer les sentiments d’empathie et d’antipathie nécessaires pour nous intéresser à toutes ces destinées. Vous suivrez entre autres Jimmy McNulty, flic doué, tête brulée et alcoolique notoire, mais aussi Bubbles, un toxicomane indic qui essaie de s’en sortir tant bien que mal. Partageant la tête du clan « Barksdale » avec Avon Barksdale, on découvre Stringer Bell qui suit des cours de macroéconomie et rêve de gérer son trafic comme un business devant répondre aux lois du marché (l’homme rationnel par excellence, à mon sens une intéressante métaphore d’un certain néo libéralisme). Il y a aussi Tommy Carcetti, un conseiller municipal qui rêve d’une grande carrière politique. Vous rencontrerez également l’un des personnages télévisuels les plus intéressants de ces dernières années : Omar Little, un homme au code moral très particulier. Rejeté par son milieu à cause de son homosexualité, il vole aux trafiquants pour s’enrichir. Il essaie néanmoins d’éviter les violences et morts inutiles. Une des forces de la série est d’emmêler et de croiser les thématiques sans les confiner à une saison.
/Culture/Entrees/2013/10/25_Way_down_in_the_hole_%28the_Wire%29_files/droppedImage-filtered.png)
Omar Little : “ I got the shotgun, you got the briefcase. It’s all in the game though, right?”
Côté structure, la lentille grossissante se déplace chaque saison et l’univers se complexifie constamment. L’existence de fils conducteurs permet néanmoins de garder une unité au tout. La première saison nous introduit dans le milieu policier. Le point de vue change continuellement entre différents trafiquants et dealers de l’ouest de Baltimore et une équipe d’enquête qui veut faire tomber les têtes du gang qui sévit dans cette zone. La deuxième saison nous emmène sur le port de la ville, un lieu en déclin où la contrebande de marchandises est omniprésente et le monde syndical important. La troisième saison focalise en partie notre attention sur les luttes politiques pour le pouvoir et le leadership social, sans oublier le commerce de la drogue omniprésent et ses multiples implications. La quatrième saison nous emmène dans le monde scolaire et le système éducatif, alors que la cinquième et dernière saison s’attache à décrypter le monde des médias, particulièrement celui de la presse.
La hiérarchie (scolaire, politique, policière, …) exige souvent des résultats à court terme. Pour les plus politologues ou passionnés par les différentes théories d’administrations et politiques publiques d’entre vous (APP un jour, APP toujours !), on trouve disséminées de nombreuses excellentes illustrations de phénomènes de captation du pouvoir, de «street level bureaucracy» et j’en passe. Les politiques mises en place souffrent continuellement d’une tension entre résultats immédiatement visibles et efficacité à long terme. Leurs effets concrets sur les gens ou encore les contraintes structurelles ne sont que des exemples parmi d’autres.
Les deux hommes à l’origine du projet The Wire, Simon et Burns, connaissent très bien Baltimore dont ils sont tous deux originaires. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à insuffler dans leur œuvre leurs convictions héritées de leur expérience de terrain. La réalité sociale et politique de la ville sert souvent à alimenter l’intrigue. Nous pouvons prendre l’exemple du problème de drogues et de violences dans la ville. Il était devenu si important dans les années 80 et 90 que le premier maire noir de la ville, un ancien procureur du nom de Kurt Schmoke, fut le premier maire d’une grande ville américaine à défendre une politique de dépénalisation des drogues accompagnée de programmes visant à mieux prendre en charge les toxicomanes.[2]
Or dans la série on retrouve le major Colvin qui, confronté au manque de résultats évidents de la politique anti-drogue menée et à la nécessité d’améliorer ses statistiques, veut tenter un changement de paradigme. Il va ordonner à ses hommes de tolérer (et, de fait, de légaliser) le commerce de stupéfiants dans un quartier particulier. Son but déclaré est alors de concentrer le type de population concerné par l’usage et la vente de drogues dans un même lieu afin de faire baisser la criminalité et de pouvoir aussi mieux cibler la prise en charge et la prévention. Les dealers n’ont plus besoin de s’entre-tuer pour un coin de rue et la population est satisfaite de ne plus avoir ce commerce sous les yeux. Une expérience qui, malgré ses résultats, sera mal vue et rejetée parce que politiquement inacceptable. Ce sentiment d’impuissance s’illustre notamment dans un dialogue que l’on peut entendre à un certain moment entre deux policiers parlant de la guerre contre la drogue : « -You can’t even call this shit a war -Why not ? -War ends ».
/Culture/Entrees/2013/10/25_Way_down_in_the_hole_%28the_Wire%29_files/the-wire-season-1-tv-show-image.jpg)
J’espère avoir éveillé votre curiosité sur cette œuvre trop méconnue à mon sens. Les questionnements sur la justice sociale, sur l’éthique, sur les rapports de pouvoir et de domination entre individus ne sont pas réservés aux cours universitaires ou aux allées de bibliothèques : Jack Bauer a ses dilemmes moraux, The Wire ses conflits sociaux et ce ne sont que deux exemples parmi des milliers. Le savoir recouvre de multiples et passionnants visages. Par ailleurs, si ce sujet particulier vous intéresse mais que son support vous rebute, David Simon a rédigé deux livres consacrés à Baltimore : Homicide: A Year on the Killing Streets (1991) et The Corner: A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood (coécrit avec Ed Burns) (1997). La traduction française de ces deux écrits est disponible.
Deux autres séries ont été créées par Simons et Burns après l’expérience The Wire, toujours avec le même souci d’authenticité. Treme (2010 – en production) débute trois mois après le passage de l’ouragan Katrina et tire son nom du Tremé, un quartier de la Nouvelle-Orléans. Les habitants essayent de reconstruire leur vie, leur ville et leur culture. La série, comme la ville, a une touche musicale très marquée (particulièrement le Jazz, mais pas uniquement)[3]. Generation Kill (2008) est une mini-série de sept épisodes d’environ soixante minutes. Elle est basée sur le roman éponyme d’Evan Wright, reporter embarqué au sein du 1er Bataillon de reconnaissance du Corps des Marines des États-Unis en 2003 pour la Guerre d’Irak. La série a elle aussi un style proche du documentaire et montre une guerre sombre, mal préparée, dont les raisons dépassent les soldats impliqués.[4]
Il est difficile de rendre justice à la complexité de The Wire, œuvre puissante qui dépasse même probablement l’entendement de ses créateurs. Chaque épisode pourrait être vu et revu, on pourrait en décortiquer les rapports de genre, de sexe et de classe, sans néanmoins jamais abandonner un réel plaisir à suivre l’histoire et ses multiples intrigues. Mais c’est la sincérité et la justesse de son propos qui lui permettent selon moi d’atteindre le statut intemporel de chef d’œuvre. Il y a, toutes proportions gardées, quelque chose de Zola dans The Wire. Beaucoup se sont rêvés peintres des fresques de l’entreprise humaine, peu peuvent se targuer d’y être parvenus. Plongez-y, laissez-vous séduire et, pour le rendre encore plus agréable, n’hésitez pas à toujours accompagner le périple d’un bon verre « de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous »[5]!



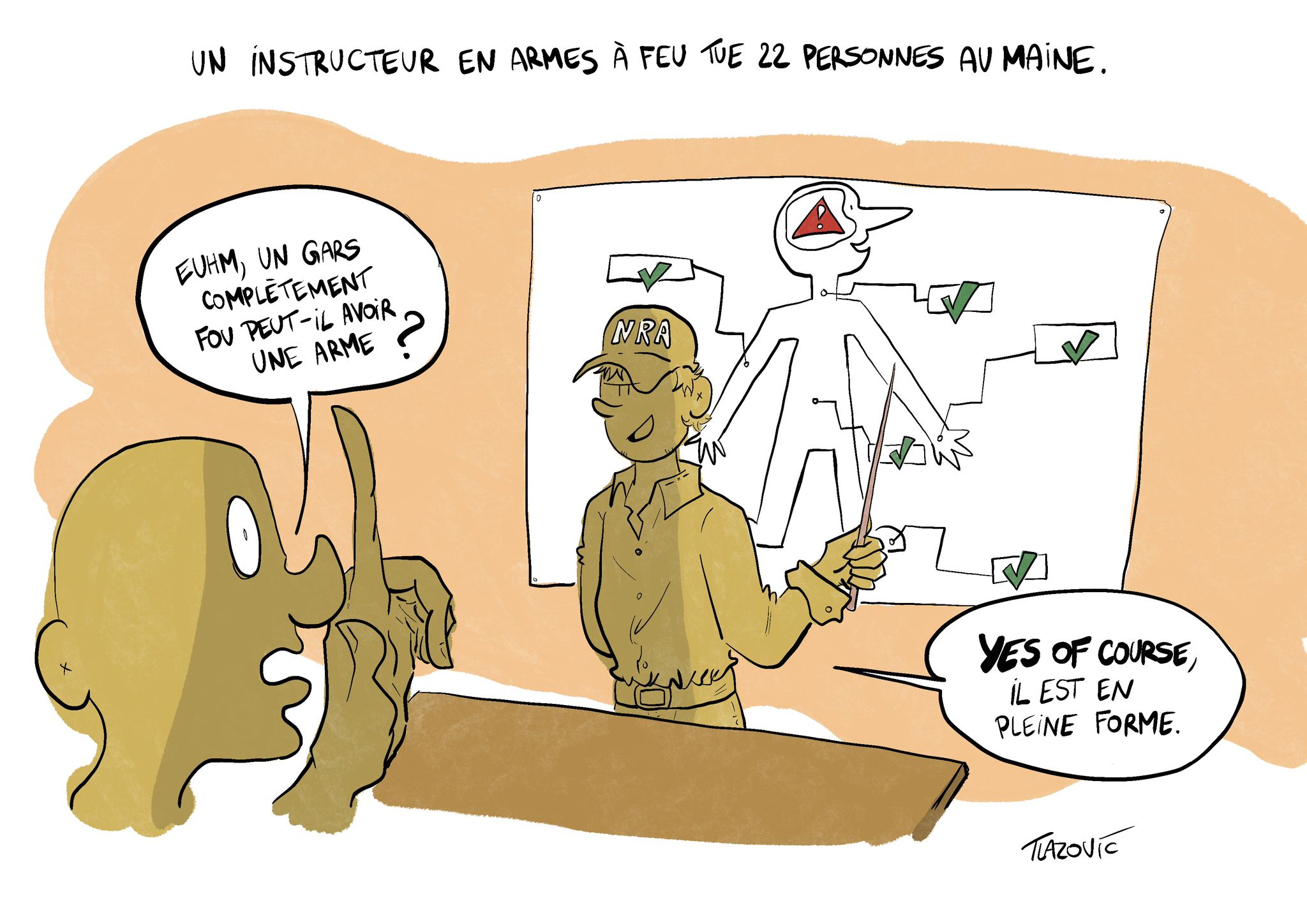
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.